
Penser qu’un contrat est universel est l’erreur la plus coûteuse pour un entrepreneur québécois qui fait affaire en Ontario.
- En Common Law, seule la lettre du contrat compte; l’intention ou l’« esprit » de l’entente, si cher au droit civil, a peu de poids.
- Une simple promesse sans un échange de valeur (la « contrepartie »), même symbolique, peut rendre votre accord invalide.
Recommandation : Ne transposez jamais vos réflexes civilistes. Chaque contrat hors Québec doit être analysé comme un document évoluant dans un système juridique fondamentalement différent, où l’implicite n’existe pas.
Pour un entrepreneur québécois, la signature d’un contrat avec un partenaire à Toronto ou aux États-Unis ressemble souvent à une simple formalité. Les termes semblent familiers, la poignée de main est franche, l’affaire est conclue. Pourtant, sous cette surface rassurante se cache un changement de paradigme juridique total. En franchissant la rivière des Outaouais, vous ne changez pas seulement de province, vous quittez le « filet de sécurité » prévisible du Code civil du Québec pour entrer dans l’univers de la Common Law.
Dans ce système, les habitudes et les protections implicites sur lesquelles vous comptez au quotidien s’évaporent. Les discussions sur l’intention commune, la bonne foi présumée ou les obligations non écrites mais logiques perdent leur prépondérance. On entre dans un monde où le contrat n’est pas un simple guide, mais un univers complet et autonome. Chaque mot compte, chaque virgule a un poids, et surtout, ce qui n’est pas écrit n’existe tout simplement pas.
Cet article n’est pas un cours de droit, mais un guide de survie pour l’entrepreneur québécois. Son but est de décortiquer les différences pratiques et les pièges concrets qui distinguent un contrat régi par la Common Law d’un contrat civiliste. Nous allons déconstruire les réflexes qui, bien que pertinents au Québec, peuvent s’avérer dangereux en Ontario, en Alberta ou ailleurs au Canada.
De la nécessité absolue d’une « contrepartie » à la puissance redoutable des décisions judiciaires passées, en passant par les risques de dommages punitifs, nous vous armerons pour que votre prochain contrat hors Québec soit une source d’opportunités, et non de responsabilités imprévues.
Pour vous guider à travers ces différences fondamentales, cet article explore les aspects les plus critiques qui distinguent la Common Law du droit civil dans un contexte d’affaires. Le sommaire ci-dessous vous permettra de naviguer directement vers les points qui vous interpellent le plus.
Sommaire : Naviguer les différences contractuelles entre le Québec et les autres provinces
- La lettre du contrat : pourquoi l’intention compte moins en Common Law qu’en droit civil ?
- Promesse de contrat : l’erreur d’oublier la « contrepartie » qui rend votre entente invalide en Ontario
- Dommages punitifs : quand un tribunal de Common Law peut-il vous condamner à payer une fortune ?
- Jurisprudence : comment une décision de 1920 peut bloquer votre projet actuel en Alberta ?
- Faux amis juridiques : pourquoi « Warranty » et « Guarantee » ne veulent pas dire la même chose ?
- Appels d’offres provinciaux : comment une entreprise du Nouveau-Brunswick peut gagner un contrat au Québec ?
- CGV béton : comment inclure une clause qui limite votre responsabilité en cas de bug majeur ?
- Poursuite ou médiation : comment régler un litige commercial sans y laisser votre chemise ?
La lettre du contrat : pourquoi l’intention compte moins en Common Law qu’en droit civil ?
Au Québec, vous avez l’habitude qu’un juge, en cas de litige, cherche à découvrir l’« intention commune des parties » au-delà des mots parfois maladroits du contrat (art. 1425 C.c.Q.). C’est un réflexe rassurant : si l’esprit de l’entente est clair, la forme peut être pardonnée. En Common Law, ce filet de sécurité disparaît presque entièrement. Le principe de base est l’interprétation littérale. Le contrat est considéré comme un document complet et exhaustif, un univers clos. Les juges partent du principe que si les parties, surtout dans un contexte commercial, voulaient inclure une condition, elles l’auraient écrite noir sur blanc.
Cette approche explique pourquoi les contrats de type ontarien ou américain sont souvent beaucoup plus longs et détaillés. Ils visent à anticiper toutes les éventualités, car il n’y a pas de Code civil pour combler les silences ou les oublis. Chaque terme, chaque définition et chaque procédure doivent être méticuleusement définis à l’intérieur même du document. Pour un entrepreneur québécois, le danger est de signer un contrat qui semble couvrir l’essentiel, en supposant que la « logique » ou la « bonne foi » combleront les vides. C’est une erreur potentiellement coûteuse, car en Common Law, un vide est simplement un vide, pas une invitation à interpréter.
Ce tableau, basé sur une analyse de la Banque Mondiale, résume les différences fondamentales d’approche entre les deux systèmes.
| Aspect | Common Law (Ontario) | Droit Civil (Québec) |
|---|---|---|
| Source principale du droit | Décisions judiciaires comme source la plus importante de la loi | Droit codifié avec accent particulier sur le Code civil |
| Interprétation du contrat | Important de définir l’ensemble des termes qui régissent la relation dans le contrat lui-même | Plus de flexibilité, le juge peut rechercher l’intention commune des parties au-delà du texte |
| Longueur des contrats | Contrats généralement très longs pour être exhaustifs | Contrats souvent plus courts, les lacunes étant comblées par les dispositions du Code civil |
Promesse de contrat : l’erreur d’oublier la « contrepartie » qui rend votre entente invalide en Ontario
En droit civil québécois, un échange de consentements suffit généralement à former un contrat. Si vous promettez de livrer un service et que votre client accepte, l’entente est née. En Common Law, il manque un ingrédient essentiel : la contrepartie (consideration). Ce concept, étranger au droit civil, stipule que pour qu’un contrat soit valide, chaque partie doit recevoir quelque chose de valeur en échange de sa promesse. Il doit y avoir un bénéfice pour celui qui promet et un détriment pour celui qui reçoit la promesse.
Une promesse gratuite (par exemple, « je m’engage à vous offrir une année de maintenance supplémentaire sans frais ») est généralement non exécutoire en Common Law, car vous ne recevez rien en retour. De même, modifier un contrat existant exige une « nouvelle » contrepartie. Vous ne pouvez pas simplement accepter de baisser votre prix sans que le client ne vous offre quelque chose en échange, même une chose symbolique comme une prolongation du contrat d’une journée ou un paiement de 1$. Cette valeur n’a pas besoin d’être équivalente, mais elle doit exister. L’oubli de ce principe peut rendre une modification de contrat, même signée, totalement invalide.
Le concept de contrepartie est au cœur de la formation des contrats en Common Law, où une simple poignée de main ne suffit pas s’il n’y a pas un échange tangible ou une promesse d’échange.

Cet échange mutuel est la pierre angulaire de la validité de l’accord. Sans lui, même la promesse la plus formelle peut n’être qu’un « cadeau » révocable.
Votre plan d’action : valider une modification de contrat en Common Law
- Identifier la nouvelle contrepartie : Qu’est-ce que chaque partie donne ou reçoit de nouveau dans cette modification ? Cela peut être une somme d’argent (même 1 $), un service additionnel, ou l’abandon d’un droit.
- Assurer la réciprocité : S’assurer que chaque partie au contrat promet de donner ou de faire quelque chose en retour de la promesse de l’autre. Une promesse unilatérale n’est pas suffisante.
- Vérifier les trois piliers : Confirmez la présence des trois éléments essentiels d’un contrat en Common Law : l’accord (offre et acceptation), l’intention d’être légalement lié, et la contrepartie (consideration).
- Documenter par écrit : Mettez par écrit toute modification, en identifiant clairement la nouvelle contrepartie fournie par chaque partie pour éviter toute ambiguïté.
- Éviter la contrepartie passée : Une action déjà accomplie (past consideration) ne peut pas servir de contrepartie pour une nouvelle promesse. L’échange doit être contemporain ou futur.
Dommages punitifs : quand un tribunal de Common Law peut-il vous condamner à payer une fortune ?
Au Québec, les dommages-intérêts visent principalement à compenser la perte subie par la victime. L’idée de « punir » un cocontractant avec des dommages exemplaires est une exception strictement encadrée par la loi (art. 1621 C.c.Q.), souvent limitée à des contextes de droits fondamentaux. En Common Law, le concept de dommages punitifs est beaucoup plus large et discrétionnaire. Un tribunal en Ontario ou en Alberta a le pouvoir d’octroyer des sommes considérables non pas pour compenser la victime, mais pour punir un comportement jugé particulièrement répréhensible, malveillant ou de mauvaise foi.
Cette réalité augmente considérablement le risque financier. Alors qu’une rupture de contrat au Québec pourrait vous coûter le montant du préjudice direct, la même situation en Common Law, si elle est accompagnée d’un comportement jugé malhonnête ou abusif, pourrait vous exposer à des millions de dollars en dommages punitifs. Ce risque est particulièrement saillant dans les litiges émergents; une étude récente montre par exemple que 40% des organisations ont vu leur exposition aux litiges de cybersécurité augmenter en 2023, des domaines où la conduite peut être facilement qualifiée de négligente ou de mauvaise foi.
L’objectif de ces dommages va bien au-delà de la simple réparation, comme l’explique une analyse de l’Université de Sherbrooke sur le sujet :
L’attribution de ces dommages vise à punir l’auteur de cette conduite, à dissuader les tiers d’agir de la même façon et à marquer la désapprobation du tribunal.
– Université de Sherbrooke, Les dommages punitifs en droit québécois
Cette philosophie de punition et de dissuasion, bien que présente de façon limitée au Québec, est un principe général bien plus ancré en Common Law. Pour un entrepreneur québécois, cela signifie que la manière de gérer un conflit ou une rupture de contrat est aussi importante que la rupture elle-même. Toute apparence d’arrogance ou de malveillance peut transformer un litige commercial standard en une condamnation financière exorbitante.
Jurisprudence : comment une décision de 1920 peut bloquer votre projet actuel en Alberta ?
En droit civil québécois, la loi est la source première du droit. La jurisprudence, c’est-à-dire l’ensemble des décisions des tribunaux, sert à interpréter la loi mais ne la remplace pas. En Common Law, la relation est inversée : la jurisprudence est une source principale du droit. Le système repose sur la règle du précédent (stare decisis), qui signifie « s’en tenir aux choses décidées ».
Concrètement, une décision rendue par une cour supérieure devient contraignante pour toutes les cours inférieures dans des cas futurs similaires. Cela signifie qu’un jugement rendu dans une affaire de construction en Alberta en 1920 pourrait encore aujourd’hui dicter l’issue de votre litige contractuel si les faits sont jugés analogues et si le précédent n’a jamais été renversé par une cour d’un niveau plus élevé. Le droit n’est pas contenu dans un seul livre, mais est dispersé dans des centaines d’années de décisions judiciaires.
Pour un entrepreneur québécois habitué à pouvoir se référer au Code civil pour connaître ses droits et obligations, cette approche est déstabilisante. L’analyse d’un contrat en Common Law ne peut se faire uniquement en lisant le document. Elle exige une recherche jurisprudentielle pour comprendre comment des clauses similaires ont été interprétées par les tribunaux par le passé. Une clause qui vous semble claire et inoffensive pourrait avoir été invalidée ou interprétée d’une manière totalement inattendue dans un jugement historique. Ignorer cet historique, c’est naviguer sans carte dans un océan de précédents qui ont force de loi.
Faux amis juridiques : pourquoi « Warranty » et « Guarantee » ne veulent pas dire la même chose ?
Le langage des contrats en Common Law est truffé de termes qui ressemblent au français mais dont la portée juridique est très différente. Ces « faux amis » sont des pièges redoutables pour un entrepreneur québécois qui pense comprendre un contrat en anglais par simple traduction. La nuance entre ces termes peut avoir des conséquences financières de plusieurs millions de dollars.
Le couple le plus célèbre est Condition vs Warranty. En français, on pourrait traduire les deux par « condition » ou « garantie ». En Common Law, la distinction est fondamentale. Une Condition est une clause si essentielle au contrat que sa violation permet à la partie lésée de considérer le contrat comme annulé et de réclamer des dommages. Une Warranty, en revanche, est une clause secondaire. Sa violation ne donne droit qu’à des dommages-intérêts pour la perte subie, mais n’autorise pas l’annulation du contrat. Confondre les deux peut vous amener à résilier un contrat illégalement, vous exposant ainsi vous-même à une poursuite.
Le vocabulaire juridique est une science exacte où chaque mot a été défini et testé par des siècles de jurisprudence, créant un fossé entre le langage courant et sa signification contractuelle.
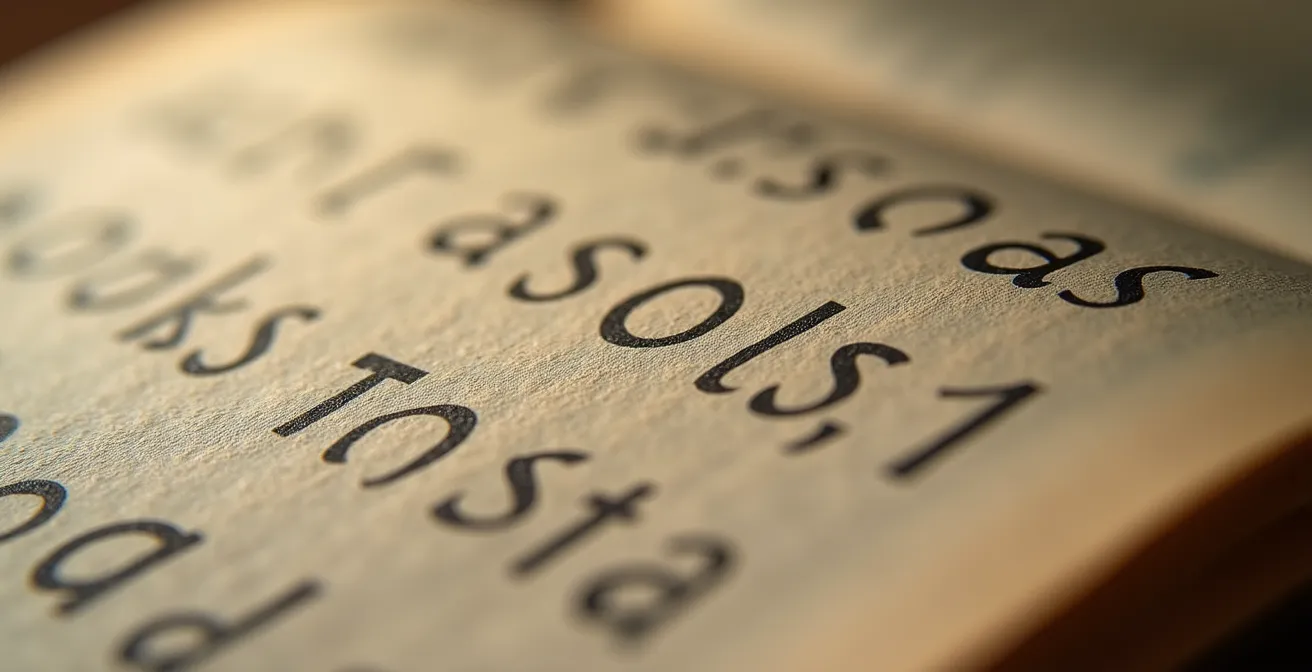
Voici quelques autres exemples de termes à manier avec une extrême précaution :
- Indemnity (Indemnisation) : Souvent plus large qu’une simple garantie, une clause d’indemnity peut vous obliger à couvrir toutes les pertes de votre partenaire (y compris les frais juridiques) découlant d’un événement, même si vous n’avez commis aucune faute.
- Best Efforts (Meilleurs efforts) : Cette norme est beaucoup plus exigeante que son équivalent français. Elle peut obliger une entreprise à faire tout ce qui est commercialement possible, parfois jusqu’au seuil de la faillite, pour atteindre un objectif.
- Reasonable Efforts (Efforts raisonnables) : C’est une norme moins stricte que Best Efforts, correspondant davantage à ce qu’une entreprise prudente et déterminée ferait dans des circonstances commerciales normales.
Appels d’offres provinciaux : comment une entreprise du Nouveau-Brunswick peut gagner un contrat au Québec ?
Les marchés publics sont un domaine où les différences entre droit civil et Common Law sont particulièrement marquées. Lorsqu’une entreprise du Nouveau-Brunswick (Common Law) soumissionne pour un contrat public au Québec (droit civil), elle doit s’adapter à un cadre juridique plus flexible, mais tout aussi rigoureux. Au Québec, le processus est régi par la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP), qui s’appliquait à 407 organismes publics au 31 mars 2024. Cette loi impose des règles strictes sur l’admissibilité, l’intégrité et la conformité des soumissions.
À l’inverse, une entreprise québécoise qui soumissionne en Ontario ou au Nouveau-Brunswick se heurte au concept du « Contrat A / Contrat B », une création purement jurisprudentielle de la Common Law. Selon cette doctrine, le simple fait de déposer une soumission en réponse à un appel d’offres crée un premier contrat, le « Contrat A ». Ce contrat lie le soumissionnaire aux règles du processus d’appel d’offres. S’il tente de retirer sa soumission après la date limite, il commet une rupture du Contrat A et peut être forcé de payer des pénalités, souvent équivalentes au montant de son dépôt de soumission.
Ce n’est que si la soumission est acceptée que le « Contrat B » – le contrat de construction ou de service lui-même – est formé. Cette approche formaliste contraste avec celle du Québec où, bien que des règles existent, la jurisprudence a parfois permis de considérer des soumissions contenant des irrégularités mineures, en se concentrant sur la compétitivité et l’équité du processus global. Pour une entreprise québécoise, le formalisme du « Contrat A » représente un risque important : une fois la soumission déposée, il n’y a plus de retour en arrière possible sans conséquences financières.
CGV béton : comment inclure une clause qui limite votre responsabilité en cas de bug majeur ?
Que ce soit au Québec ou en Ontario, il est courant d’insérer dans les conditions générales de vente (CGV) une clause limitant ou excluant sa responsabilité en cas de problème, comme un bug informatique majeur. Cependant, la validité de cette clause n’est pas évaluée de la même manière dans les deux systèmes. Au Québec, une telle clause est généralement valide, sauf si elle contrevient à l’ordre public ou si elle exonère une partie de sa faute lourde ou intentionnelle (art. 1474 C.c.Q.).
En Common Law, la validité d’une clause limitative de responsabilité est soumise à un test beaucoup plus contextuel et imprévisible. Les tribunaux se demandent si la clause est « raisonnable » (reasonable) et si elle n’est pas « déraisonnable » (unconscionable) au moment de la formation du contrat. Pour être jugée valide, la clause doit avoir été clairement portée à l’attention de l’autre partie, surtout si celle-ci est un consommateur ou une petite entreprise avec un faible pouvoir de négociation. Une clause enfouie en petits caractères au fond d’un contrat de 50 pages a de fortes chances d’être invalidée par un juge ontarien.
La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Tercon, a établi un test en trois étapes que les tribunaux de Common Law appliquent pour déterminer si une clause d’exclusion de responsabilité doit être appliquée :
- Interprétation : La clause, en tant que question d’interprétation, s’applique-t-elle aux circonstances factuelles du litige ?
- Caractère déraisonnable : Si elle s’applique, était-elle déraisonnable au moment de la formation du contrat (par exemple, en raison d’une inégalité de pouvoir de négociation) ?
- Ordre public : Si la clause est valide, y a-t-il une raison d’ordre public prépondérante qui justifierait de ne pas l’appliquer (par exemple, en cas de fraude ou de criminalité) ?
Ce test donne aux juges une grande latitude pour écarter une clause qu’ils estiment injuste, un pouvoir d’intervention bien plus grand que celui de leurs homologues québécois en matière contractuelle purement commerciale.
À retenir
- Paradigme : Le droit civil (Québec) protège l’intention et comble les vides via le Code. La Common Law (Ontario) donne le pouvoir absolu au texte écrit du contrat.
- Validité : En Common Law, pas de contrat valide sans « contrepartie » (consideration). Une simple promesse ne suffit pas, un échange de valeur est requis.
- Risque : Les dommages punitifs sont une menace réelle et potentiellement exorbitante en Common Law si votre comportement est jugé répréhensible, bien au-delà de la simple compensation pratiquée au Québec.
Poursuite ou médiation : comment régler un litige commercial sans y laisser votre chemise ?
Lorsqu’un conflit commercial éclate, le réflexe peut être d’intenter une poursuite. Cependant, le coût, la longueur et l’incertitude des processus judiciaires, tant au Québec qu’en Ontario, poussent de plus en plus d’entreprises vers des modes alternatifs de règlement des conflits (MARC), comme la médiation ou l’arbitrage. Dans un contexte économique où l’on observe une augmentation de 28,6% des insolvabilités commerciales en 2024 par rapport à l’année précédente, éviter un litige coûteux devient une question de survie.
La médiation est un processus volontaire où un tiers neutre (le médiateur) aide les parties à trouver leur propre solution. Le médiateur ne tranche pas le litige, mais facilite la communication. C’est une méthode rapide, peu coûteuse et confidentielle, qui préserve souvent la relation d’affaires. L’arbitrage, quant à lui, est plus formel : les parties choisissent un ou plusieurs arbitres qui entendront la cause et rendront une décision finale et contraignante, qui a la même force qu’un jugement de tribunal. C’est plus rapide et souvent moins cher qu’un procès, mais plus rigide que la médiation.
Le choix entre ces options dépend de la nature du conflit, de la relation que vous souhaitez préserver avec votre partenaire et des ressources que vous êtes prêt à investir. Le tableau suivant, basé sur des données de l’industrie, compare les ordres de grandeur pour un litige commercial typique en Ontario.
| Méthode de résolution | Coût moyen | Délai moyen | Taux de satisfaction perçu |
|---|---|---|---|
| Poursuite judiciaire | 50 000 $ – 500 000 $+ | 2 – 5 ans | ~45% |
| Médiation | 5 000 $ – 50 000 $ | 3 – 6 mois | ~75% |
| Arbitrage | 20 000 $ – 150 000 $ | 6 – 12 mois | ~65% |
Inclure une clause de règlement des différends dans vos contrats est une mesure préventive intelligente. Vous pouvez y prévoir une étape de médiation obligatoire avant toute poursuite, vous donnant une chance de résoudre le problème à l’amiable et à moindre coût.
Maintenant que vous êtes armé de cette compréhension des différences fondamentales, l’étape suivante consiste à passer de la connaissance à l’action. Pour sécuriser vos opérations hors Québec, une analyse proactive de vos contrats types par un conseiller juridique familier des deux systèmes est la meilleure stratégie pour transformer les risques en certitudes.
Questions fréquentes sur les contrats en Common Law vs Droit Civil
Comment fonctionne le système de précédents en Common Law?
Le terme ‘précédent’ fait référence à une décision de justice qui fait autorité pour trancher des affaires ultérieures impliquant des faits identiques ou similaires. Les tribunaux sont tenus de suivre les décisions des cours supérieures, ce qui assure une certaine prévisibilité. Le précédent est la source historique et principale de la Common Law.
Les décisions anciennes sont-elles toujours applicables?
Oui, absolument. En vertu du principe de stare decisis, les décisions antérieures restent contraignantes tant qu’elles n’ont pas été explicitement renversées par une juridiction supérieure ou distinguées sur la base de faits différents. Une décision du début du 20e siècle peut donc toujours être la loi applicable aujourd’hui.
Quelle est la différence avec le système civiliste du Québec?
Au Québec, la source première du droit est le Code civil, un corps de lois écrites. La jurisprudence aide à interpréter ce code, mais ne le remplace pas. En Common Law, même si les lois écrites (statutes) sont très importantes, la jurisprudence (les décisions des juges) est historiquement considérée comme une source primaire du droit, créant des règles là où la loi est silencieuse.